Conversation avec François Piron et Guillaume Désanges
Pour le catalogue de l'exposition monographique Instruments au Jeu de Paume
Paris, France
décembre 2016
Lien vers l'exposition Instruments
Entretien / pdf
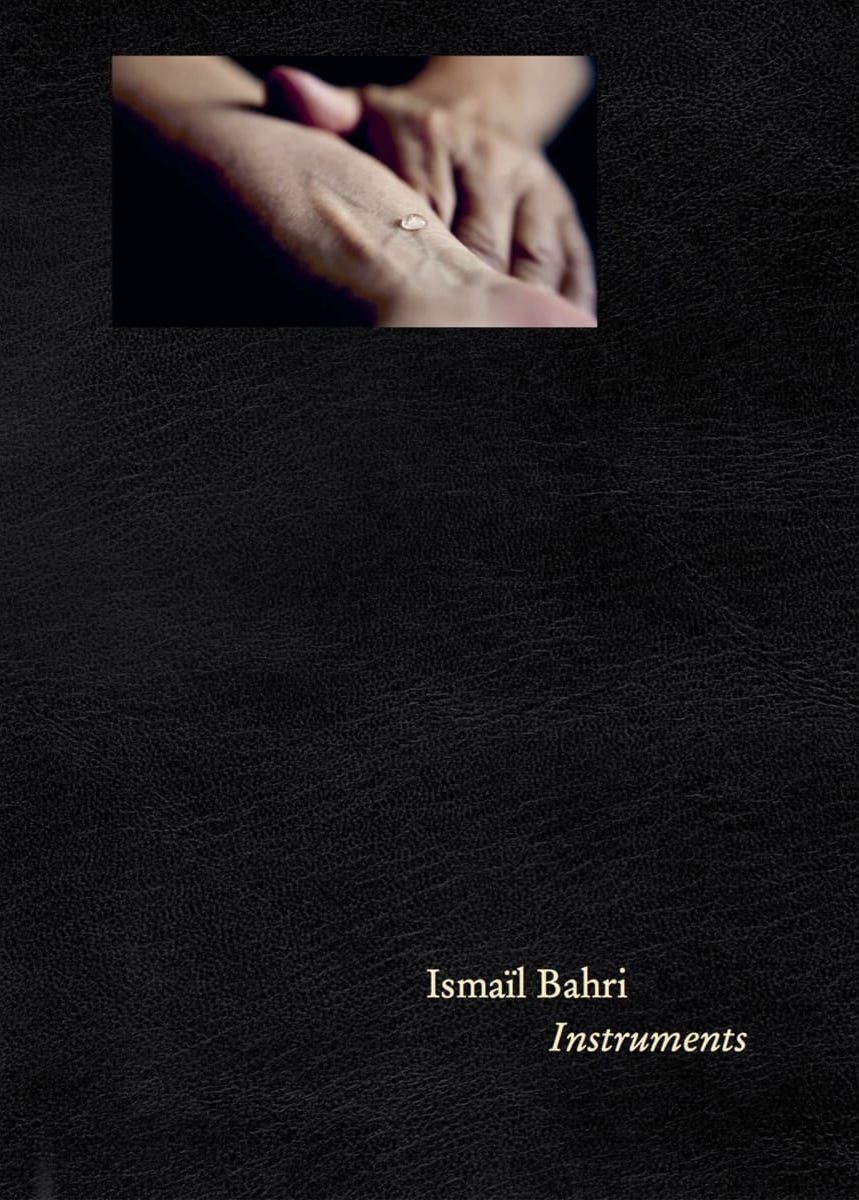
Paru en juin 2017
Edition bilingue (français / anglais)
ISBN : 978-2-915704-68-6
EAN : 9782915704686

Guillaume Désanges : Ton œuvre est ouverte. Il est difficile de savoir de quoi elle parle exactement. Il semble y avoir une volonté d’effacement de ce qui pourrait être trop situé ou trop référencé, pour laisser la place à un essentialisme ou pour se débarrasser d’un horizon politique, social et contextuel.
François Piron : Pour aller vers une polysémie, mais aussi vers une forme d’épure ou d’élémentarisme. Est-ce un processus conscient dans ton travail que d’effacer des traces de contexte ? Des gestes apparaissent toujours dans des situations, mais on a l’impression que tu fais attention à ne pas les mettre en avant.
Ismaïl Bahri : J’ai le sentiment de ne pouvoir travailler qu’à petite échelle, l’attention portée sur des choses très précises. Travailler consiste avant tout à isoler du bruit ambiant un élément à observer. Ce qui peut induire que l’expérience soit coupée de son contexte d’origine mais j’essaye de faire en sorte que le détail observé convoque - un peu comme en acupuncture -l’énergie qu’il traverse ou qui le traverse. Il arrive parfois – mais c’est très rare –, que le fait de préciser, d’évider une surface ou d’aller à l’épure, convoque un peu ce qui l’entoure.
FP : Le processus, chez toi, tend vers une épure, alors que cela pourrait être l’inverse, d’autres artistes vont ajouter des couches, stratifier, augmenter, etc. Au contraire, tu essaies de garder une ligne précise, de trouver le geste sur lequel tu vas faire porter toute l’attention.
IB : Oui. Et travailler, pour moi, ne peut se faire que dans la répétition. Répéter une expérience pour essayer d’y déplier quelque chose que je n’aurais pas prévu. Et le plus souvent, chaque nouvelle expérience réagit à un travail antérieur, et s’inscrit, oui, dans une ligne assez précise.
GD : Ton travail tend vers une épure jusqu’à la réalisation de la pièce, puis se produit l’effet inverse de la complexification du réel. La volonté d’avoir la chose la plus neutre possible impressionne tout le reste, parce qu’il n’y a pas de programme défini. La métaphore photographique joue beaucoup avec les questions d’émulsion et d’un papier qui serait sans image, qui pourrait impressionner l’image autour.
IB : La métaphore photographique de l’impression et de l’exposition m’intéresse beaucoup. Je travaille rarement depuis des partis pris prédéfinis à l’avance. Les gestes et les expériences que je fais se font généralement à l’aveugle sans que je comprenne ce que je suis en train de faire. Je cherche à m’étonner moi-même, mais ces moments arrivent rarement ; disons, une fois ou deux en six mois de travail à peu près. Je recherche ces moments-là, car c’est là que la matière travaillée semble le mieux s’exposer à l’énergie qu’elle traverse ou qui la traverse.
FP : Est-ce qu’il n’y aurait pas de notion de contrôle dans ton travail ?
IB : Si, et elle est même grande. J’ai beaucoup de mal à me lâcher. Pour espérer voir quelque chose il faut des rituels et faire des choix. Mais, en même temps, travailler consiste, pour une grande part, à laisser les choses se faire un peu d’elle-même. En ce sens, je ne cherche pas tant à exprimer qu’à faire en sorte que les choses s’impriment. Peut-être le retrait vient-il de là. Comme si je ne pouvais envoyer un signal dans le monde que sous forme d’impression.
GD : Je comprends pourquoi tu nies la question de la perte de contrôle. Il y a beaucoup de délégation de pouvoir, à la situation, au hasard et à la chance. Cette situation est contrôlée à l’inverse ; tu contrôles le fait de ne pas trop déterminer des possibilités. Tu délègues au vent, à la personne que tu vas rencontrer, mais tu ne contrôles pas a priori ce que cela va donner.
IB : La décision se fait moins dans ce que je voudrais exprimer à l’avance que dans ce que je décide de garder de ce qui arrive.
FP : Tu le dis dans le film, il s’agit d’une étude sur la lumière. Le moment où tu es étonné arrive quand ton attention est déplacée. Ce n’est pas tant cette étude sur la lumière qui constitue le centre du travail, mais plutôt ce qu’elle te fait faire et ce qu’elle provoque dans l’environnement où tu filmes.
IB : C’est bien ça. J’ai passé des mois à focaliser sur des éléments purement formels liés à la lumière. Jusqu’à ce que je me rende compte que ce qui active le travail provient des marges, des voix que j’avais omis d’entendre. Le film est donc arrivé sans que je le sache. Il s’est fait un peu de lui-même.
GD : Le contrôle réside en un protocole minimal et dans le choix de ce que tu gardes. Mais j’ai du mal à croire qu’il n’y ait pas un pressentiment, parce que tu vas dans des endroits précis. On se pose la question du rapport au réel.
Tu prépares une exposition personnelle au Jeu de Paume, dont on sait que c’est un lieu qui présente en ce moment une exposition titrée « Soulèvements [1] » - à laquelle tu participes. Tu es également associé au FID [2], à Khiasma [3], tu travailles avec Olivier Marboeuf, tu t’entoures de personnes qui traitent de sujets politiques. Ce n’est pas un hasard que tu sois associé à cette scène. Ces lieux que je viens de citer énoncent des programmes clairs, ils ont une vision. On a l’impression que ce qui fait la singularité de ton travail à l’intérieur de ce champ arriverait malgré toi, or cela ne peut pas être un hasard. Tu n’aurais pas gardé juste une étude sur la lumière, donc il est difficile de croire qu’il s’agit d’une étude sur la lumière, c’est plus politique.
IB : En effet, les choses sont compliquées. Je me sens tiraillé entre plusieurs points, sans cesser de passer d’un point à l’autre.
FP : Quelles sont alors ces coordonnées ?
IB : D’un côté, j’ai un véritable intérêt pour les choses formelles et phénoménales et, de l’autre, j’ai la tentation d’aller me frotter au dehors avec ce qu’il induit de social ou de politique. Il m’arrive parfois d’essayer d’amorcer mes expériences au milieu de ces deux coordonnées, pour voir où cela m’emmène. Mais si le travail se laisse parfois plus affecter par l’un ou l’autre des pôles, je ne crois pas que cela se fasse de manière intentionnelle. C’est moins programmatique qu’énergétique je crois.
FP : Tu te méfies du vouloir dire. Car des intentions, tu en as, tu tends vers des choses, et les polarités dont tu parles sont des régimes intentionnels.
IB : Oui, dans ce sens, tu as raison. Mais j’ai l’impression que cette part intentionnelle ne peut tenir que si elle passe par l’entremise d’intercesseurs multiples, par d’autres énergies ou intensités qui viendraient l’affecter ou la troubler. Ca peut être les incertitudes du vent, de la gravité, du passage d’un nuage, l’incalculable de l’autre qui arrive dans le champ de l’expérience…
FP : Est-ce que tu le considères comme un stratagème ?
IB : Oui, c’est une tactique qui se ferait de proche en proche, en fonction des situations. Je ne me sens à l’aise qu’à petite échelle, là où je peux avoir la main sur un lâcher prise. Et quand j’arrive à placer mon curseur au milieu de ces deux points, entre retrait et contrôle, une recherche peut parfois s’amorcer.
FP : Ces intentionnalités sensibles sont tangibles. Le travail montre une vulnérabilité à travers différents gestes, à travers cette polysémie et cette ouverture. Il me semble que la question de la vulnérabilité est perceptible à un niveau plus physique qu’intelligible.
Je pense aussi au tremblement. Dans Revers, comme dans Foyer, l’attention est déplacée. Pour Foyer, il n’y a rien à voir, il n’y a pas d’image. Le déplacement est clair ; l’attention se déplace sur ce qui s’entend et qui n’est pas visible. Dans Revers, très vite, on regarde tes mains avec une sensation très désagréable, tactile, d’une chose qui crisse, qui tache, qui est affectée physiquement ; c’est presque douloureux. Tout ceci n’est pas donné d’emblée par la nature du geste, mais dans une coulée douce. Quand on regarde de près le tremblement, on commence à réaliser l’appareillage, on voit plus l’extrême vulnérabilité du dispositif qu’une expérience de science naturelle sur la gravité.
IB : Mon rapport à la vulnérabilité est très fort. Je sais qu’il comporte le risque du trop fragile du malléable ou du trop confus. Je fais très attention à ce que mes expériences soient accompagnées d’une certaine précision.
FP : La répétition est un outil d’insistance.
IB : La répétition aide à s’épuiser et à épuiser les choses pour en retenir le peu qui résiste. J’essaie d’arriver au point où ça tient mais dans l’espoir que de ce point quelque chose continue d’échapper, une vulnérabilité s’exprimant par des opérations de transfert des matières, des tremblements, des vibrations…
GD : La vulnérabilité est liée à l’objet lui-même. L’instrument, qui est l’objet du film, peut-être que pour le rendre appropriable, il se doit d’être fragile ? Comme pour la monnaie, c’est la question de l’objet transactionnel. L’objet d’échange ne peut être que faible physiquement ; lorsqu’ils sont seuls, la monnaie et le langage sont faibles. De même qu’un objet passif ne peut pas être discursif. La fragilité, par exemple du verre d’encre ou de la feuille blanche, est nécessaire pour faire un objet de passage, un objet catalytique.
Nous avions déjà évoqué ensemble les cinémas de Robert Bresson ou Abbas Kiarostami. Par sa passivité, l’âne de Balthazar [4] – qui est un héros faible – déclenche les passions autour de lui. Le cahier, dans Où est la maison de mon ami ? [5], pris à l’échelle de l’enfant, n’est qu’un prétexte à parler de ce qui existe autour de lui. L’âne et le cahier sont des intercesseurs. Giorgio Agamben a écrit un essai [6] sur le rôle des assistants dans la littérature, qui sont des personnages faibles, passeurs d’une situation particulière. Ils sont les objets de la passion, donc fragiles, parce qu’ils doivent être mobiles.
GD : Ceci n’empêche pas la précision. Bresson est le cinéaste de la précision et de la fragilité ; ces deux notions sont compatibles.
IB : L’exemple de Balthazar est en cela parfait. Il y a vraiment l’idée de choisir un référentiel passif, neutre, blanc, une chose qui peut être remplie, peuplée. Mais à force d’évider, de travailler depuis une forme de neutralité, il existe le risque de voir le travail approprié et tiré vers des pôles qui peuvent ne pas me plaire. Cela arrive.
FP : Revenons à cette question de l’articulation entre vulnérabilité et politique. Il y a clairement un horizon d’attentes politiques vis-à-vis de ton travail. En quoi cette vulnérabilité est-elle politique ? Est-ce que c’est cela qui est projeté dans ton travail ? C'est-à-dire que les personnes se diraient qu’Ismaïl Bahri fait de la politique par la vulnérabilité, ou que tu évoquerais un réel fragile, un rapport au dehors tremblé.
IB : Je vois bien qu’il existe ces attentes politiques. Et, on ne va pas se le cacher, mes origines peuvent exciter des grilles de lectures liées au monde arabe. Je m’en méfie. Peut-être que le recours aux situations vulnérables ou à une certaine forme d’abstraction ajuste une meilleure distance vis-à-vis de ces attentes. Un peu comme s’il s’agissait de penser le politique depuis ses pôles les plus éloignés et préserver un feuilleté plus complexe de sens.
GD : La situation de base a beau être fragile, il y a une évolution qui fait que cela se résout dans les pièces, puisque la situation n’est jamais suspendue. Ceci rejoint encore les cinémas de Bresson et Kiarostami, où la fameuse scène finale vient relire tout ce qui a été vu avant, et qui était une situation posée. Comme dans Foyer ou Dénouement [7], cela commence par une situation abstraite qui finit par être résolue. Le danger de l’appropriation infinie est oblitéré par le moment où il y a la décision de montrer cette situation résolue à un public. La décision n’arrive peut-être jamais à un moment précis, mais à la fin il y a un objet terminé.
FP : Ton travail rentre dans un moment où la sphère des émotions est requalifiée, par rapport à il y a quelques années où était mise en avant une dimension plus intellectualisée, plus affirmative en termes de vouloir dire et d’un certain régime d’œuvre d’art. J’ai l’impression qu’il y a de nouveau un tournant qui permet de redonner une place à la question de l’émotion. Cette inquiétude, qui est peut-être le sentiment dominant que le travail révèle, est comprise dans un régime très contemporain. Ton travail va être présenté à la Biennale de Sharjah, et je ne pense pas qu’il y aurait été inclus il y a six ans, il serait apparu comme trop essentialiste et trop poétique.
IB : Je vois très bien ce que tu veux dire, bien qu’Orientations y ait été présentée en 2013.
GD : Orientations a été montrée à l’époque pour son bord géopolitique. Dans ton travail, il y a aussi la question de remettre en cause la décision de l’auteur créateur et l’acte créatif. L’acte créatif est-il de prendre des décisions, ou bien comme le souligne Catherine Malabou, l’acte créatif est-il de révéler ? La poésie qui revient aujourd’hui est moins programmatique, plus intuitive ; elle laisse un certain réel couler plutôt que de laisser la décision venir trancher et créer quelque chose à partir de rien.
IB : Lorsque je travaille, j’attends d’arriver au moment où je reconnais quelque chose. C’est comme si les choses avaient toujours été là et que travailler consiste à essayer de les reconnaitre. Je crois que c’est dû au fait que je cherche à des endroits primaires, voire primitifs. Les gestes, les matériaux, de même que les notions sont très élémentaires. Tout ceci convoque le générique, un référentiel commun, un déjà vu. Je pense, par exemple, à l’ombre, au feu, à la projection, ou à des gestes s’inscrivant dans la lignée de gestes expérimentés par chacun d’entre nous comme le fait de nouer, de dévider, de froisser, d’enrouler. J’essaie de m’inscrire dans cette lignée mais pour y reconnaître quelque chose qui m’étonne.
FP : Pour un artiste, la question de la singularisation se pose. En quoi le travail n’est justement pas un déjà-vu, non seulement un phénomène mais une opération ? Tu sembles être sur une zone qui conteste cela, et qui se met en danger.
GD : Dans l’imaginaire, de la modernité à aujourd’hui, le principe d’un artiste est de créer un truc qui n’existe pas. Tandis que tu reviens à une « attitude » grecque, à l’idée platonicienne selon laquelle les idées existent, elles ont été oubliées, il s’agit alors de les rappeler. Croire aux phénomènes existants remet en cause l’autorité – au sens d’auteur – de l’artiste.
IB : Je suis d’accord. Il y a ce mouvement constituant à laisser apparaitre les choses et à agir un peu comme un catalyseur. Je trouve que l’impératif de la singularité peut inhiber le travail et l’envie d’apprendre. C’est devenu une pensée réflexe liée au modernisme occidental. Or, je vois bien que travailler consiste à sans cesse répéter les gestes des autres. Je me trompe peut-être mais je n’ai pas l’impression que ça soit, par exemple, le cas dans les cultures extrême orientales où répéter un geste ancestral revient à l’affiner plutôt qu’à le révolutionner à tout prix. C’est très important pour moi que le travail porte en lui quelque chose d’assez « universel ».
FP : Voilà un mot qui est de la bombe.
A préciser : pourquoi « de la bombe ? »
IB : Je suis attiré par le monde asiatique et le Japon – que je ne connais pas – tout en étant très influencé par la Grèce antique, par la philosophie et la poésie occidentale. Je travaille aussi beaucoup en Tunisie, affectivement très importante pour moi. Mais comment faire pour que le travail ne soit accaparé par aucun de ces points en particulier ? Foyer, par exemple, convoque un contexte sociopolitique autant qu’une mise à plat de questions simples sur le pré-cinéma. Qu’est-ce qu’un écran ? Qu’est qu’une projection ? Qu’est qu’une caméra ? Je crois que j’ai eu besoin de travailler depuis ces questionnements natifs pour les laisser affecter des complexités qui vont les côtoyer, comme l’âne de Bresson.
FP : Jean-Christophe Bailly, dans son livre le Dépaysement [8], fait cette distinction entre origine et provenance, en disant que ce qui est plus intéressant que l’origine, qui est propriétaire, c’est la question de la provenance. Remonter le fil des éléments avec lesquels on travaille. Il y a de cela dans le démontage que tu fais des perceptions, des phénomènes et des sentiments qui y sont associés. La question du réel n’est pas un rapport originaire, elle ne fonde pas.
GD : Tu es associé au cinéma engagé, au film. Il y a cette grande séparation entre cinéma expérimental – au sens de l’abstraction et du grattage de pellicules – et cinéma documentaire. Ces deux cinémas sont politiques, mais à un moment donné, il y a friction, chacun se demandant au service de quoi est l’autre. D’un côté, il y a la vanité du cinéma expérimental, cinéma que l’on ne peut pas accuser d’avoir été putassier puisqu’il est resté dans une misère absolue, dans des zones confidentielles, qui a une éthique et qui a souffert de la domination. De l’autre côté, il y a le cinéma documentaire qui a aussi une éthique, au service de laquelle nous sommes. Des personnes comme toi, et d’autres, dépassent cette séparation qui joue sur l’engagement dans la forme et la forme de l’engagement ; pas de lutte de forme s’il n’y a pas de forme de lutte. Ces questions sont restées tendues – Jean-Luc Godard participait déjà à ces questions dans les années soixante – et sur des modes de trahison mutuels et permanents. Les documentaristes allant vers une trahison des formes, on les accusait de propagande et les autres étaient accusés de faire de l’art pour l’art, ce qui était un autre type de trahison. Ce sont les deux écueils possibles de cette coupure. Tu te situes entre les deux.
IB : Je le vois bien. Il arrive que certaines personnes aiment une partie du travail, et pas l’autre. Alors que les deux forment un tout. Les formalistes purs et durs pourront se demandent ce que viennent faire des mots sur un bel écran blanc par exemple. C’est amusant.
FP : Tu es dans un espace de scrupules. Tu laisses en tension les deux polarités de l’abstraction et du document. Le scrupule est quelque chose de moral, il y a le désir de ne pas trahir l’équilibre qui existe entre ces deux polarités ; de ne pas faire l’artiste arabe par exemple. De même que tu ne nies pas tes conditions de vie ni de travail.
IB : Je me sens plus à l’aise avec le pôle formel, que je saisis d’emblée, et de façon quasi instinctive, qu’avec le pôle plus social ou politique qui va convoquer en moi plus de méfiance et de questionnements. Cela me titille, je me sens travaillé.
GD : Cela te travaille toi, et l’œuvre. Ce peut être même une situation laborieuse comme dans Orientations.
FP : La recherche du point de vue, de la bonne distance, de la netteté ; arriver à faire le point. On passe sans cesse de l’abstraction, aux gestes et au réel. Il y a une évolution permanente entre ces trois focales.
GD : C’est encore la métaphore photographique, ou celle de la naissance : ça travaille. L’installation « Sommeils [9] » à Khiasma était laborieuse – pas au sens négatif du terme. Cela était dû aux multiples écrans. Cela aurait pu n’être qu’un dispositif visuel suspendu, un exercice. Mais l’exercice amène à quelque chose, dont la résolution était Foyer, projeté au bout de l’installation. C’était très beau, comme une mise en partage de ton économie de travail. L’œuvre travaille elle-même et la question du travail est aussi celle du temps, du laisser-faire.
IB : Oui, c’est ce qui persiste dans Foyer. Le film donne à sentir son énergie de travail. Les passants venus m’aborder mettent des mots sur le film en train de se chercher.
GD : Néanmoins tu as conservé les moments où les passants te demandent si tu es d’ici ou là-bas. Quelqu’un te dit même : « Un tunisien ne ferait pas ça, il aurait honte. » Cela renvoie à ta propre condition, qui est belle parce qu’elle n’est pas juste discursive, elle est ouverte.
FP : C’est la tonalité première des dialogues entendus dans le film. Dans une autre phrase, quelqu’un parle de la couleur de ta peau et te dit que tu n’es pas complètement tunisien, tu es trop blanc, tu as l’air malade, alors que lui et les autres sont noirs et brûlés par la vie.
GD : Malgré toi, vient la métaphore des motifs de blancs et quelqu’un se demande où tu te situes dans le spectre des couleurs. Ce n’est en effet pas une intention de ta part, en revanche il y a un effet de montage.
IB : Dans Foyer, je souhaitais arriver à toucher le réel depuis un rapport de nuances. Le questionnement de départ est très simple, un peu de type aristotélicien. Comment faire un film de rue depuis un rapport de nuances ? Comment capter les variations lumineuses d’une surface blanche ? Comme enregistrer les infimes variations d’un courant d’air ? Et puis de fil en aiguille, je me suis rendu compte que telle parole ne renvoyait pas un même sens selon qu’elle est posée sur telle ou telle tonalité de blanc…Toutes ces variations s’affectent les unes les autres pour activer la mécanique même du film. Au final, le morceau de papier devient une sorte d’instrument mesurant l’écart entre une forme d’abstraction et les réalités de la rue.
GD : Cette question de la nuance n’est-elle pas au cœur du travail ? La nuance, c’est la non coupure, c’est l’idée du développement et donc du film. C’est la persistance rétinienne à tout point de vue, éthique, moral et politique.
FP : On y retrouve le transfert, l’imprégnation, la révélation.
GD : Tout ceci n’est qu’une question de nuances.
IB : C’est pour cela que la question du film m’intéresse. Je me suis rendu compte que je cherche à filmer ce qui peut « faire film », c’est à dire des choses prises dans un processus de transformation, de développement par petites différences. Ca peut être un fragment de journal qui se déroule, une image qui s’affaiblit, une fil rembobiné donnant à voir tous les degrés de transformation d’une ligne en pelote et ainsi de suite…. La nuance devient cinématique.
GD : Et la décision artistique se prend un moment après, dans l’arrêt. Comme la métaphore du développement photographique, en passant au fixatif, quelque chose s’arrête. En revanche, ce temps n’est pas défini par avance. Il n’y a pas un protocole. Tu laisses faire jusqu’à ce que tu sois étonné puis tu prends la décision. Avant c’est une histoire de nuances, de mutations et de déclinaisons.
IB : Je travaille jusqu’à reconnaître quelque chose qui attire mon attention et cherche ensuite à le moyen de capter les degrés de variations de cette chose. Pour Revers, par exemple, le processus de reconnaissance a consisté à éprouver les différentes qualités de toutes sortes de pages de magazines. J’ai froissé tout ce qui est possible et imaginable : Le Monde, Libération, Cosmopolitan, Figaro Madame etc. J’ai essayé de comprendre comment les papiers et les différentes images – textures, grains, fibres – réagissent à l’opération que je leur faisais subir. Et c’est en observant leur réaction que j’ai commencé à reconnaître un film potentiel et par connaitre la durée de ce film.
GD : On reste dans un régime formel. C’est le papier qui a décidé du choix de la publicité. Tu le fais avec Libération ou Tunis Matin, ce n’est pas pareil, tu en rajoutes. Or ici, il y a une signification malgré toi.
FP : Tu t’inscris dans un régime plus générique qu’une image située et pointant du doigt un phénomène particulier ou une temporalité précise.
IB : C’est en effet plus générique. Encore une fois, le travail part de deux pendants, l’un purement matériologique, et l’autre plus signifiant. La rencontre des deux a fixé le travail. Ce qui ne veut pas dire que c’est la pièce idéale, elle aurait pu être meilleure et plus intéressante.
FP : En cours d’élaboration, nous avions évoqué plusieurs subtilités dont le papier qui ne doit pas se déchirer avant que l’encre l’ait complètement quitté. Il fallait que la feuille reste intacte, sinon on passait à un autre, voire à plusieurs régimes connotatifs. Tu gardes bien une ligne. J’ai l’impression que pour toi, il ne faut pas qu’il y ait trop d’accumulation des connotations, sinon l’objet se charge de vouloirs dire.
IB : Oui.
GD : Mettre en place, de manière obsessionnelle et précise, les conditions du hasard.
FP : S’il n’y a pas cette précision, toute poésie est menacée par la sensiblerie.
GD : Le danger réside en la disparition. C’est encore la question de la résolution. Si cela restait suspendu, il se pourrait que ce ne soit plus grand chose. Ton travail est fragile, mais cela se résout, même si la résolution est appropriable et non déterminée.
FP : Il y a bien un renversement. Et au niveau de l’intelligible, ou en terme de compréhension, c’est très vite vu, en quelques secondes. Dans Revers en particulier, intervient la question de la violence. La tension se déplace non plus sur le geste de froisser et défroisser, mais vers les mains, vers ce qui leur arrive, comment elles sont affectées et abîmées. Le son est mis en avant, et on arrive très vite à quelque chose de beaucoup plus haptique que conceptuel. La téléologie du projet s’épuise très vite au profit d’une immanence de la violence. Tu ressens une douleur à distance. Ce froissement est aussi pénible que la craie qui crisse sur le tableau.
GD : Il n’y a pas de suspense.
FP : Toutes les pièces ne fonctionnent pas exactement de la même manière. Dans Foyer, il y a une certaine idée de la résolution avec le déroulé narratif, ce qui n’est pas du tout le cas dans Revers où le geste se réitère sans fin, avec différents papiers ; la différence réside dans le micro détail. C’est en cela qu’il n’y a pas de téléologie ni de progrès.
GD : Il y a aussi une fascination très conceptuelle par rapport à ton travail, qui n’est ni uniquement formelle, ni politique ou sociale, qui est la question de la disparition et de l’effacement, de la dématérialisation absolue. Une fois la chose effacée, il y a la possibilité d’appropriation et de projection de l’image effacée. C’est ce qui se passe dans Source [10], où une flamme brûle une feuille. C’est une stratégie d’effacement.
FP : J’infléchis cette chose plutôt du côté du transfert, puisque c’est ce que la disparition permet de révéler.
IB : Au fur et à mesure qu’il progresse, le cercle convoque quelque chose du corps qui le borde. C’est un processus d’élargissement ; du point central aux alentours.
GD : C’est plus classiquement conceptuel, car cela rejoint des expériences de John Cage qui devaient devenir un art de mélodies que l’on n’entend pas, de films que l’on ne voit plus. Il y a toute une histoire du film potentiel. Mais finalement, tu ne te situes pas vraiment là.
IB : L’exposition « Nul si découvert [11] » parlait de cela. Il y avait une incapacité à résoudre. Toutes ces œuvres étaient des expériences impossibles. Il y avait une aporie.
GD : Ce n’était pas l’effacement, mais plutôt l’inaccessible.
FP : Si nous avions eu connaissance de ton travail plus tôt, nous t’aurions probablement invité dans « Intouchable [12] ».
GD : L’œuvre de Jirí Kovanda recoupe plusieurs endroits que nous venons d’évoquer. Il ne filme pas l’effacement de ses œuvres, mais nous savons qu’elles vont s’effacer puisque ce sont des situations qui vont se dégrader, qui sont invisibles. Kovanda, qui agit dans un certain contexte, est associé à des questions sociales et politiques, de résistance, tout en s’en dédouanant.
FP : Il accepte le regard porté sur le travail, légitime par essence.
GD : C’est universel. Dans un entretien [13], il dit que s’il n’avait pas été à Prague, il aurait fait le même travail ailleurs, et peut-être plus simplement. Il parle d’horizontalité et de verticalité. Pour lui le poétique est l’horizontal, le plan, le contextuel, mais que son travail est vertical. Entre l’abscisse et l’ordonnée, il vient se détacher et percer ce plan d’immanence. Il accepte ce plan horizontal et poétique, mais il travaille sur des notions verticales. Lorsque tu parles de la manière dont ton travail peut être approprié politiquement parce qu’il est pris dans un plan d’immanence horizontale, je pense à cet artiste.
FP : C’est la preuve qu’il pense comme un sculpteur.
GD : Il est formaliste et poétique.
IB : C’est très beau. J’ai découvert son travail grâce à vous.
FP : Ce mot, « universel », ne va pas de soi aujourd’hui. Il présuppose qu’il y aurait une forme d’égalité de perception, que tout le monde pourrait être à égale distance d’une proposition donnée. Comment assumes-tu cette question de l’universalité ? Est-ce que c’est un vœu ?
IB : J’ai plutôt le sentiment que c’est naturel. Je suis intéressé par plusieurs choses et n’ai pas d’intérêt culturel ou géographique déterminé. L’universel renvoie à mon intérêt pour les choses natives qui ont plus facilement tendance à être transversales. Je me reconnais là dedans.
GD : Je pense qu’il faut se réapproprier ce mot, il n’est pas exclusif ; le problème, c’est l’universalisme, considérer l’universel comme un universel, considérer l’universel au carré. L’universel en soi ne peut pas être nié. Il n’empêche pas les particularismes. Il y a même un universel qui dépasse l’humain. Il y a une crispation pénible autour de ce mot. Ton travail a foi en la question de l’universel et il le montre. Lorsque j’entends la manière dont les personnes s’expriment en Tunisie, ce n’est pas la démonstration d’un ailleurs ou d’un exotisme. La manière dont ces jeunes parlent du travail montre que, s’il y a un projet politique, il existe un universel de la réception de l’art et que l’on peut parler d’autre chose en disant précisément des choses qui ne sont pas situées dans l’essence de ce qui est dit.
FP : Cela tisse du lien, sans créer de l’altérité.
GD : Cela ne fait que du lien entre un spectateur, par exemple ici à Paris, avec ces personnes du film. Peut-être tu peux le faire parce que tu es le seul à le savoir. Tu es tendu entre ta position personnelle, intime et sociale, et tu es une nuance de cela. Notre relation à cette réalité politique est aussi une question de nuance, sans coupure.