Conversation avec Septembre Tiberghien
Revue Possible n°1
l'hiver 2018
Lien vers l'entretien
Entretien / pdf
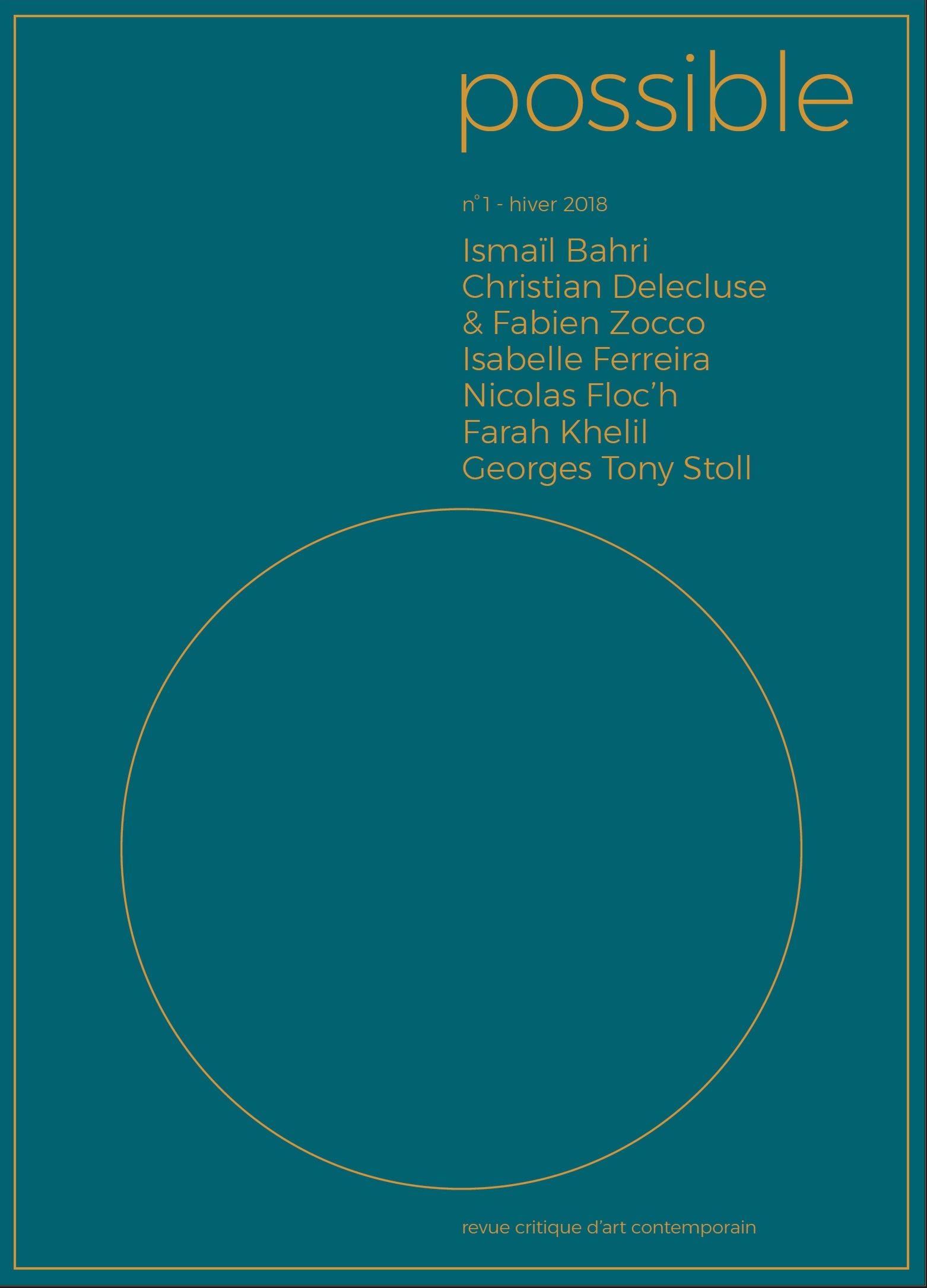
Les émotions esthétiques, celles qui nous bouleversent et nous façonnent profondément, sont rares. En visitant l’été dernier l’exposition d’Ismail Bahri au Jeu de Paume (1), j’ai été saisie par le fait que d’aussi petits gestes puissent provoquer un tel désir de rapprochement. Comme si les vidéos projetées là permettait de s’immerger dans toute une série d’états intérieurs, qui au lieu d’induire l’isolement, la solitude, facilite au contraire la rencontre avec autrui. Le consensus. Conséquemment, j’ai eu envie de faire la connaissance de l’auteur de ces images. C'est ainsi que nous nous sommes rencontrés, un lundi matin de la fin du mois d’août, à Paris, dans son atelier.
Septembre Tiberghien : Peux-tu nous raconter la genèse de ton exposition ? Est-ce que le parti pris de faire de l’exposition une sorte de camera obscura - était présent en amont ou s’est imposé seulement ensuite ?
Ismaïl Bahri : La construction de l’exposition s’est faite de manière organique, par petites touches. La première idée étant l’interpellant visuel à l’entrée, cette goutte perçue depuis l’encadrement de la porte. À partir de là nous avons agencé le reste avec l’intuition de construire une sorte de développement, quelque chose qui se transforme lentement, par capillarité. Chaque image en appelant une autre. L’exposition commence par des captations d’expériences faites dans des intérieurs intimes et calfeutrés, très liées à des transformations de matières et de choses. Puis, à mesure que l’on progresse, les images s’effacent, s’évident ou se surexposent. On finit sur la blancheur lumineuse du film Foyer. Cette progression développe un paradoxe, car plus l’image s’efface et plus le dehors arrive. La montée du blanc s’accompagne d’une ouverture aux éléments, aux vents et aux voix. Mais tu l'imagines bien, ces intuitions restaient à vérifier dans l'espace.
ST : Tu veux dire qu’il n’y a pas eu un travail préalable dans la galerie qui t’aurait permis de développer cette pensée dans l’espace.
IB : Assez peu et je trouve ça dérangeant. Il m’est difficile de me projeter sans être dans l’espace. Et il n’y a rien de plus plaisant que de travailler sur le lieu même, en présence des images, des vides et des pleins. C’est arrivé un peu, mais pas tant que ça.
ST : Il y a une sorte de pivot, de point nodal autour de la vidéo « Dénouement », qui est la force d’attraction conduisant le spectateur d’un point à l’autre de l’exposition.
IB : C'est juste, c’est la colonne vertébrale de l’exposition. On a construit ce couloir qui conduit le spectateur vers Dénouement. Marcher vers cette vidéo c’est avancer en direction de la silhouette qui approche vers nous. C’est un rapport de symétrie, de miroir. Cette vidéo est importante parce qu’elle porte en elle quelques éléments importants de l’exposition : la question du détail, de l’échelle, de la durée, de l’accommodation optique. Elle a été synchronisée à la vidéo Source parce qu’elles font toutes deux huit minutes et qu’elles convoquent pratiquement les mêmes choses. Les deux proposent une progression lente : dans Source, un trou noir se creuse et dans Dénouement, un corps obscur se révèle. Elles ne cessent de décliner ensemble de la lumière à l’obscurité faisant de la salle une sorte de coeur battant qui teinte énergétiquement le reste des projections. À partir de là, j’ai compris que l’exposition se construisait autant par l’action de l’image que par les énergies lumineuses que produisent les vidéos. Je crois que c’est aussi pour ça que la vidéo m’intéresse. Parce qu’elle véhicule des images depuis des énergies.
ST : C'est la vie en mouvement.
IB : Oui, les images vidéos sont des lumières qui éclairent, qui s’assombrissent, qui tremblent, qui varient et qui produisent des ombres. La projection vidéo taille des images dans la luminosité qui nous entoure. Dénouement, par exemple, a été projetée en grand pour affecter énergétiquement les autres vidéos et pour faire en sorte que vienne s'y découper la silhouette des spectateurs.
ST : J’ai eu l’impression qu’il y avait autant de choses révélées que de choses cachées dans ton exposition. Comme si une vidéo pouvait également en éclipser une autre. Le sens n’est pas immédiatement donné, il y a un mystère qui subsiste dans ces actions ou ces phénomènes qui invite à une lecture polysémique du travail. La vidéo Revers, par exemple, m’a évoqué de multiples significations malgré ou plutôt grâce à son dénuement et à sa simplicité. C’est quelque chose d’assez ténu, qui se tient sur le fil.
IB : Peut-être. Tout ce que je sais c’est que je travaille à partir de ce qui a déjà été fait, d’un déjà-là. Je ne suis pas obsédé par l’idée de renouveler le travail, de le réinventer chaque jour. Les pièces naissent les unes depuis les autres, par boutures. Ça implique des répétitions, des déclinaisons. Une polysémie peut naître de ce genre d’opérations. Par exemple, Revers éclôt depuis Dénouement. À partir des dernières secondes du film où l’on voit en plan serré les mains du personnage qui rembobine le fil. Je me suis dit qu’il y aurait mille développements à faire depuis ce moment-là. Je suis parti de là pour développer le geste répétitif de Revers. Mais ça s’est fait plutôt inconsciemment sans que je ne comprenne trop ce que je faisais. J’ai l’impression que les pièces les plus réussies sont les plus intuitives. Les pièces les plus conscientes sont à mon sens ratées. Il faut quelles soient au croisement d’un programme et d’une sorte de non conscience, de non savoir. Revers part d’une manipulation intuitive, faite à l’aveugle dans l’atelier, pour devenir, à force de répétitions, assez lancinante.
ST : Oui, c’est peut-être la pièce la plus programmatique de l’exposition. On entre dans le temps d’un rituel, d’un geste qui est répété tellement de fois qu’il peut en devenir irritant. La dimension sonore a sans doute avoir là-dedans aussi. En même temps, c’est un geste fascinant, presque envoutant. On ressent une sorte d’ambivalence à son égard.
IB : C'est la dernière pièce que j’ai faite, parce qu’en construisant l’exposition, j’ai senti qu’il manquait un contrepoint au caractère volontairement plat, lent et atone du début du parcours. Revers se pose comme un écho abrasif à cette platitude quasi immobile. Plus tard, je me suis rendu compte que cette vidéo porte en elle la progression soustractive de l’exposition : on part de l’image imprimée vers le blanc, d’une chose pleine vers sa soustraction. J’avais une version précédente de Revers, que j’ai montré à la Biennale de Rennes, et en la montrant là-bas, j’ai senti qu’elle présentait un problème. Je l’ai donc reprise pour la préciser, la pousser encore plus loin. C’est quelque chose que je fais de plus en plus maintenant. Je profite des expositions pour mettre à l’épreuve les pièces. Et la friction avec le réel, le recul, le fait de prendre le temps de voir et d’en discuter fait qu’il m’arrive de reprendre des pièces et de les déplier autrement. Revers et Foyer sont le développement d’anciennes versions par exemple. L’exposition, dans ce sens serait à comprendre au sens chimique, comme l’exposition d’une pellicule à une lumière, à son dehors. L’exposition n’est pas une fin en soi mais une sorte de vecteur. Une hypothèse que l’on confronte aux contradictions extérieures et, plus tard, une réaction opère qui donnera forme aux expositions suivantes.
ST : Deux choses m’ont marqué dans l’exposition : le format des vidéos et la construction très précise des cadrages, qui en disent long sur l’acte de monstration. Par exemple dans Revers, à chaque fois que tu arrêtes de chiffonner cette feuille, tu la montres au spectateur. Ce geste de désignation est à la fois subtil et très fort. La manière dont tu as cadré l’image, en focalisant sur l’action, ne laisse pas de place à l’identification de l’individu ni à l’espace où se déroule l’action.
IB : C’est un personnage oui. Ça peut être n’importe qui.
ST : On retrouve la même chose dans Dénouement, la tête du personnage est coupée. Pourtant, la vidéo demeure très en prise avec le réel, très concrète.
IB : C’est juste. Je suis touché par les artistes qui sont au croisement d’une certaine forme de déréalisation et de quelque chose de brut.
ST : Cette feuille que tu chiffonnes, elle devient quelque chose d’autre au fur et à mesure. Elle se transforme. Il y a une métamorphose. Ça devient une peau, ça passe par toute sorte d’état. Qui sont peut-être comme tu le disais le reflet des expositions précédentes. Une sorte de prisme. Qui renvoie à la dernière vidéo de l’exposition. Quelque chose me chiffonne néanmoins, sans vouloir faire de mauvais jeu de mot, c’est que nul part dans le texte de présentation, il n’est question d’une dimension politique dans le travail, alors que j’ai l’impression de la retrouver partout. Dans Revers, il y a quelque chose de très iconoclaste : on assiste à la mort de l’image. Dans Foyer, la feuille de papier qui masque l’objectif de la caméra est un prétexte à faire parler les gens et à révéler toute sorte d’attitudes très contrastées vis-à-vis de l’image volée ou capturée.
Ais-je rêvé cette dimension politique ou est-elle bien suggérée ?
IB : Non, tu as raison. La question du politique est présente, mais j’ai tenu à ce qu’on n’insiste pas trop dessus. C'est quelque chose qui doit être éventuellement ressenti. Consciemment, je voulais juste poser les choses sans trop cadrer l’interprétation. D’où le titre de l’exposition, Instruments, qui est laconique mais qui parie sur l’éventualité que le spectateur l’affecte à sa manière, depuis l’expérience qu’il fera de l’exposition. On a juste là devant nous les instruments qui peuvent s’activer ou pas. Avec le risque que rien ne se passe évidemment. Dans ce sens, la question du politique infuse en filigrane. Elle s’inscrit dans le développement du parcours : plus l’image se soustrait et plus une place pour les autres semble se faire. Le blanc, l’incomplétude à l’image, deviennent un infinitif où se conjuguent les perceptions. Je ne sais pas, je crois que Foyer induit cela. Ce film gravite autour de la façon dont le dehors agité vient peupler le blanc à l’image. Dans ce sens, je crois que c’est un film politique. Concernant Revers, le recours à des images de publicité et à des photographies de personnages, très canoniques, et très connotés inscrit le travail dans un certain contexte. Les images froissées et évidées de leur contenu sont des publicités qu’on peut encore retrouver dans les rues de Paris. Ca permet d’inscrire le geste dans le monde. Et d’une certaine façon, le fait de froisser ces images est une façon d’entretenir une rapport frictionnel avec ce qu’induisent ces images.
ST : On sent qu’il y a une vraie maîtrise du geste. Un savoir-faire presque artisanal dans le roulement des doigts.
IB : Oui, j’ai beaucoup répété ! Notamment pour choisir les magazines à utiliser. Parce que la majorité des images se dépigmentent en vingt, voire trente minutes. Mais certaines se dépigmentent en cinq minutes. C'est très important, parce que dans ces vidéos, agir c’est filmer et inversement. Ça implique que le geste et le film se fassent mutuellement. Le développement du geste devient le déroulement du film, avec un début et une fin, une intrigue et un dénouement. J’ai travaillé avec des buralistes pour trouver des pages de magazines pouvant partir en fumée en cinq minutes, sans avoir à accélérer le mouvement. J’allais les voir, on discutait de la qualité des impressions, du grammage du papier, du contenu des images... Mais oui, il a fallu beaucoup répéter.
ST : Ça pose inévitablement la question de la mise en scène.
IB : Oui, c’est sûr. Elle est présente dans toutes les vidéos, sauf les dernières. Plus on avance dans l’exposition, moins il y a de contrôle. Mais oui, la mise en scène me pose question. Parfois, je me dis que c’est bien, parfois non. Je suis un peu perdu par rapport à ça. Je la crois importante si on la considère comme un cadre, comme ce qui permet de s’interdire des choses. Et la répétition, dans ce sens, sert à préciser, à épuiser les possibilités donc à en retenir le peu qui reste pour faire avec ce peu là. Mais tout cela n’est pas très conscient. Ce qui était présent dès le début dans Revers c’est la question du corps. J’en ai pris conscience en relisant mes notes de travail. J’y ai retrouvé cette intuition, une sorte de programme : « deux corps s’affectent mutuellement ».
ST : Oui, il y a vraiment un transfert physique qui s’opère.
IB : Un corps semble se transvaser dans un autre. L’image part en fumée à mesure qu’elle devient peau quand les doigts qui manipulent cette image se teintent de ses pigments. Et les deux peaux, celle des doigts et celle que devient le papier, finissent par se confondre, par se prolonger l’un l’autre. La question du son est importante, parce que j’ai demandé à Pierre Luzy, l’ingénieur du son, de faire en sorte que l’on soit dans le papier, à l’intérieur du geste, du grain, de la matière. Alors que le cadrage de l’image met, lui, à distance. On est par le son à l’intérieur de l’expérience et par l’image dans l’observation de cette même expérience. Je ne sais pas si ça fonctionne, mais c’était l’intuition.
ST : Effectivement, c’est assez immersif. Comment procèdes-tu ? Tu répètes jusqu’à l’obtention du geste parfait ou tu as réalisé plusieurs prises pour faire la vidéo ?
IB : J’ai fait deux jours de prise non stop. Il y en a soixante je crois. J’en ai sélectionné six. J’ai créé une variation, un peu arbitraire. Très souvent, il faut à peu près deux heures pour être dans le geste, pour le dé-automatiser et le vivre un peu comme une transe.
ST : C’est très performatif.
IB : Oui, au départ c’est très mécanique. À un moment donné, avec la fatigue et l’ennui je suppose, on prend le pli du geste. On apprend à épouser le papier en train de se transformer. On apprend à être sensible à la matière, à son poids, à la poussière qui se dégage. L’insistance produit un effet d’entraînement. Une fois pris dans ce mouvement, on se pose moins de questions. C'est pour ça que les premières prises étaient en général les moins bonnes. J’utilisais pendant l’échauffement les pages de magazines que j’aimais le moins. Un ami sculpteur, Loïc Blairon, était derrière la caméra et m’aidait, il savait reconnaître et me donner petit à petit les images qui étaient importantes. On les laissait pour la fin. Et alors une tension se créait, on se disait : celle-là, il ne faut pas la rater !
ST : Est-ce que c’est une manière de faire qui est généralisée dans ton travail, de partir d’une pratique d’atelier pour concevoir la vidéo ?
IB : Oui, j’ai vraiment une double activité. Parfois j’ai une activité de lecture et de prise de notes, qui peut durer deux ou trois semaines. Lire et écrire me concentre. Après je chamboule tout l’espace pour en faire un atelier de manipulation et de recherche. En général, je filme le travail en train de se faire. Le geste est pris dans le fait d’être filmé et inversement. Je filme pour garder des traces de ces expérimentions, mais surtout parce que je me rends compte que filmer le geste en train de se chercher me permet d’être à la fois acteur et observateur de l’expérimentation. C’est une manière d’être au centre et à la marge de ce qui se travaille. La plupart du temps, les expérimentions ne donnent rien. Mais il arrive qu’elles prennent, comme lorsqu’on trouve une prise dans la paroi d’une falaise. C’est assez rare. Très souvent cette prise est en rapport avec le sentiment de reconnaissance, avec le sentiment de reconnaître soudain une chose. On se surprend alors à considérer cette chose. On la voit enfin. Elle devient considérable. Je travaille pour ces moment-là je crois.
ST : À la manière dont tu décris ton processus, on dirait que tu recherches les évidences.
IB : Très souvent, c’est lié au déjà-vu, aux gestes mille fois faits. En discutant avec des gens à propos de l’exposition, je me suis rendu compte que tous les gestes explorés dans les vidéos sont souvent très liés à la notion de déjà-vu. Mettre le feu à une feuille, la froisser, l'enrouler : ce sont des choses que l’on a tous faites, plus ou moins expérimentées.
ST : Ça semble être des gestes liés à l’enfance.
IB : Oui, je crois que c’est très important. De creuser quelque chose qui est là depuis très longtemps. Comme une chose qu’on ne cesserait pas de rejouer. D’où la difficulté du travail, parce que c’est très difficile de préciser et de pousser plus loin ce qu’on croit connaître. La plupart du temps, travailler revient à ressasser des redites, des clichés. Il s’agit de malaxer ces clichés pour s’en étonner. J’attends l’étonnement. Ça arrive rarement, à force de persévérance.
ST : Je vois maintenant la proximité qu’il peut y avoir entre ton travail et celui d’Édith Dekyndt. Laisser advenir des choses, les laisser émerger des couches sous-jacentes.
IB : Tout à fait, je regarde beaucoup son travail. Elle fait partie de ces artistes qui m’affectent et que je laisse me traverser. Et le travail d’Édith Dekyndt me bonifie je crois. Mais j’ai le sentiment que je suis plus attachée qu’elle à la question de l’image. Alors qu’elle est plus dans l’enregistrement de l’expérience. Et ce n’est jamais aussi beau que quand elle semble le faire à la volée… Je gagnerais à m’imprégner plus de ça. Par rapport à son travail, ce qui me touche sont ses expositions, qui sont très organiques. Certaines propositions peuvent sembler très anecdotiques, mais tu sens que ça n’a pas d’importance, parce que ce sont les éléments d’une organicité. Après, je trouve que sa fascination pour les phénomènes l’amène parfois à tomber dans des facilités, quand d’autres expériences restent, elles, chargées d’une complexité, de sens notamment, qui me touche beaucoup.
ST : On peut se demander parfois si c’est l’action du hasard qui fait oeuvre.
IB : Oui, tu as raison. Et finir l’exposition par cette vidéo qui pointe vers son travail s’est fait naturellement. Ça s’est présenté comme une évidence. Quand on a filmé ce drapeau avec Youssef Chebbi, j’ai tout de suite reconnu quelque chose d’elle et je me suis dit : Edith est là ! Ce drapeau pris par le vent et les vagues est alors devenu un appel d’air vers son travail.
ST : Qui résonne assez bien d’ailleurs avec la dernière vidéo, Foyer, qui devient une sorte d’emblème.
IB : Avec le recul, je pense que toute l’exposition a été faite pour accueillir Foyer. Comme s’il s’agissait d’installer un espace préliminaire de lenteur pour être prêt, en fin de parcours, à regarder et à s’attarder sur Foyer. Le début de l’exposition est quasi immobile, à la limite de l’image fixe. Certaines vidéos semblent figées, étales. Elles nécessitent de s’en approcher pour en voir les micro-mouvements. Elles demandent à ce que l’on pose une attention, à ce qu’on leur donne du temps. Le début du parcours est très corseté, immobile, tenu, retenu. Puis, peu à peu, ça se délie, ça s’ouvre, ça s’accélère et ça s’agite. Par jeu de contrastes il me semble qu’on ressent davantage la brise d’air de la fin tant le début est contenu. Parfois il y a des gens qui me disent, j’aime bien le début, mais pas la fin ou inversement. Alors que pour moi c’est un continuum.
ST : D'autant plus qu’on est obligé de refaire le chemin à rebours pour sortir de l’exposition, ce qui implique de repasser par les mêmes seuils.
IB : J’ai failli appeler l’exposition « seuil » d’ailleurs. Mais je ne l’ai pas fait. Oui, on repasse par les mêmes seuils mais le retour se fait, je crois, habités par les voix de Foyer. La perception des autres vidéos pourrait peut-être en être légèrement changée. Je ne sais pas… j’espère. Au final, c'est la question de la nuance qui est à mon avis importante dans l’exposition. Une transformation d’état mais pas de nature que l’on retrouve clairement dans Foyer qui est un film sur la nuance. Des nuances de teintes, mais aussi des différentes perceptions d’un référent commun.
ST : C'est assez fabuleux de voir à quel point ce bout de papier peut délier les langues.
IB : Oui, ces gens projettent leurs pensées sur ce bout de papier. Ils se font du cinéma et font ainsi le film.
ST : En même temps, Foyer reste une pièce très formaliste, que je trouve personnellement très belle, avec toutes ses nuances de blanc et la subtilité qu’elle déploie. À aucun moment, on peut imaginer que cette pièce puisse être uniquement sonore.
IB : Il me semble que la friction entre l’image et le son croise deux polarités opposées : d’une part un aspect très formaliste, abstrait et lumineux et d’autre part l’agitation de la rue et des voix. C’est un peu comment peindre un Malévitch dans une rue tunisienne ! Il y a l’idée de l’intellectuel qui débarque dans la rue obsédé par une question qui peut sembler veine. Ce qui me touche avec le recul dans ce film, c’est que toutes les discussions sont spontanées. Parce que je ne savais pas ce que j’étais en train de faire à l’époque. J’étais totalement pris par l’observation de la feuille et les discussions avec les passants ont été enregistrées sans que je n’y prête attention. Ça implique que regarder le film revient à le voir en train de se chercher. Il y a une sorte de noeud reliant le moment du tâtonnement dans la rue à celui de sa transmission au public qui regarde le film. Le morceau de papier, l'écran de cinéma devient une membrane qui relie autant qu’il sépare ces deux temps et ces deux espaces. Quand j’ai réalisé ça, je me suis dit : quel heureux hasard quand même ! C’est comme le drapeau, c’est un accident de manipulation de la caméra. Quand Youssef a vu que ce tissu devenait un instrument optique qui capture le paysage, wow ! C’est pour ça que je dis, plus on avance dans l’exposition, plus l’accident survient. On aurait très bien pu axer toute l’exposition autour de ça, mais il m’a semblé important de contenir tout au début pour délier les énergies à la fin. Comme une série de préliminaires menant au relâchement final.